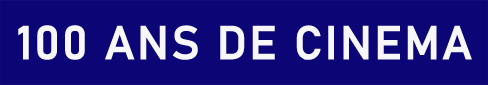De l’adversaire à l’éventuel partenaire : les figures de l’arabe dans le cinéma israélien
Avant la création de l’Etat d’Israël, en 1948, l’Arabe de Palestine était décrit dans la production cinématographique juive locale comme primitif et exotique, c'est à dire comme à la fois objet de curiosité et de dédain. Cette image n’avait rien à envier à l’image que les films coloniaux véhiculaient en Europe sur les colonisés d’Afrique, par exemple. En effet, le pionnier juif était montré comme moderne et industrieux, utilisant des équipements mécaniques pour irriguer, cultiver et construire des routes, en relation avec ses besoins d’implantation. En opposition, l’Arabe palestinien était montré, suivant l’esthétique de la pensée pionnière juive issue des mouvements modernistes et socialistes européens de la fin du 19ième siècle et du début du 20ième siècle, en compagnie de chameaux ou d’ânes, vivant dans des lieux désertiques ou peu développés, utilisant un vieil équipement pour se déplacer ou cultiver. Cette image de l’Arabe, décrit d’une manière monolithique, a totalement négligé la compréhension de sa culture.
Avec la création de l’Etat d’Israël, qui s’est développé comme une nation fière et sûre d’elle-même, les Arabes restés dans les frontières du nouvel Etat étaient considérés comme une cinquième colonne potentielle, voire assimilés à l’ennemi et traités comme tel. Ils vivaient sous un régime militaire qui leur était spécifique et dont l’une des conséquences était le couvre-feu qui leur fut imposé jusqu’en 1966.
Le cinéma israélien des années 60 commença à donner une image plus individualisée -et donc moins monolithique- de l’arabe. Cependant il le cantonnait toujours dans des rôles périphériques, y compris dans les films qui traitaient du conflit Israélo-Arabe (Sinaia, Siege, Five Days in Sinai, The Big Escape, Operation Thunderbolt). A cette époque, le cinéma israélien donnait une image ambiguë de l’Arabe israélien en l’identifiant à l’Arabe ennemi, celui de l’autre côté de la frontière, habitant les pays arabes en conflit avec Israël (armistice signé en 1949, mais il y eut les conflits militaires de 1956, 1967, 1973, 1982 et il fallut attendre 1979 pour qu’un premier traité de paix soit signé avec un pays arabe, l’Egypte).
Ce n’est que dans les années 1970-1980 que les cinéastes israéliens ont commencé à porter un regard critique sur la relation entre l’Israélien juif et l’Israélien arabe, en abandonnant l’image stéréotypée et indifférenciée de l’ennemi, pour progressivement offrir celle d’un Arabe israélien humanisé, avec sa conscience et ses besoins. En conséquence, le cinéma israélien a différencié l’ Arabe-israélien de l’ Arabe-ennemi. Cette prise de conscience par le cinéma israélien de l’existence de l’Autre en son sein, s’est étendue dans les années 1980 à l’Arabe des territoires occupés (conquis en 1967) pour aussi lui donner un visage.
Par l’intégration de l’Arabe à la réalité israélienne à travers le cinéma, celui-ci interroge l’histoire israélienne et le rapport qu’elle entretient avec son meilleur ennemi - bibliquement son cousin - et participe de ce fait de la prise de conscience de l’existence de l’Autre, en lui reconnaissant une identité que jusque là il lui refusait. Ce faisant, le cinéma israélien participe de la lente prise de conscience que Juifs et Arabes n’ont d’autre choix que vivre ensemble, quels que soient d’ailleurs les soubresauts actuels de la politique proche-orientale.
« My name is Ahmed » (Avshalom Katz, 1966) est un film emblématique car réputé être le premier film qui met subtilement et délicatement en scène un Arabe israélien. L’intérêt du film réside dans le fait que, d’une part, il touche à la multitude des problèmes de la vie quotidienne, et que d’autre part, à partir d’un portrait subjectif, le film objective la situation de l’Arabe-israélien. Le film met en scène un jeune arabe qui ne trouvant pas de travail dans son village, va dès lors le quitter pour Tel-Aviv. Mais Ahmed est confronté au fait qu’il n’est pas facile, d’une part, de trouver du travail, et d’autre part de se faire accepter dans un environnement qui n’est plus le sien : la société juive israélienne. Ahmed doit faire face à la difficulté de louer un appartement dans un environnement où l’on n'a pas envie d’avoir un arabe pour voisin. Ce refus est si fort, que quand il se promène dans les rues de Tel-Aviv il a le sentiment d’être ignoré, rejeté, voir haï. Pour contourner ces problèmes, un ami arabe d’Ahmed se fait passer pour juif depuis le jour où il s’est fait traiter de « sale arabe ». Mais pour sa part, malgré ces durs désagréments, Ahmed espère que Juifs et Arabes puissent apprendre à se respecter et à vivre ensemble.

Ce problème de la destinée commune, car c’est bien de cela qu’il s’agit, sera traité dans de nombreux autres contextes. En effet, un film comme « Beyond the Walls » (Uri Barbash, 1986) met en scène une prison israélienne de haute sécurité où se côtoient un prisonnier politique arabe et un criminel juif. Tous deux souffrent du mépris, de la violence et des manipulations que leur infligent les gardiens de la prison, qui par ailleurs contrôlent le trafic de drogue et arbitrent les droits de visite. Pour s’opposer à cette corruption une grève de la faim éclatera dans la prison et unira dans un même destin les prisonniers juifs et arabes. La présence de Juifs et d’Arabes dans un lieu confiné -comme une métaphore de l’Etat d’Israël - qui provoque la rencontre de l’Autre, est aussi traité dans « Cup Final » (Eran Riklis, 1991). Mais le sujet est politiquement plus délicat car il élargit le champ de la rencontre .
Le propos de ce film se déroule pendant la guerre du Liban en 1982. Un soldat israélien est appelé à combattre sur le front alors qu’il avait prévu de se rendre en Espagne pour y suivre la finale du ‘Mondial’ de football. Au cours d’une opération militaire il est fait prisonnier par une unité de l’OLP composée d’idéalistes, de fanatiques, de naïfs et de personnes biens organisées et politisées. L’histoire met en avant le développement de la relation qui s’établira entre le captif et ses ravisseurs. De l’hostilité du début, que chacun exprimera à sa manière, va naître une découverte de l’Autre à travers leur passion commune : ils souhaitent la victoire de l’Italie au championnat du monde de football. La camaraderie ira en se développant car le groupe tout entier doit se protéger des hostilités en cours au Liban. En effet si l’unité de l’OLP doit faire face à l’armée israélienne, elle doit aussi échapper à d’autres ennemis qui sont libanais. Ce film a le mérite d’explorer la relation entre ravisseurs et captif et de montrer leur possible coexistence dans un environnement dangereux, celui du Proche-Orient.
Cette meilleure compréhension de l’Autre trouve un beau développement dans « Avanti Popolo » (Rafi Bukaee, 1986). Durant la guerre dite « des Six Jours » (1967), deux soldats égyptiens en perdition dans le désert tombent sur une patrouille israélienne. L’un des soldats égyptiens qui est acteur dans le civil, use du moyen de communication qu’il connaît bien : le langage du théâtre. Assoiffé, il demande aussi la mansuétude par un incroyable monologue. Se souvenant de la pièce « The Merchant of Venice » il récite le monologue de Shylock : « I am a Jew. Has not a Jew eyes, emotion, senses? Do we not bleed? ». Le soldat israélien répond par le rire et ajoute « je crois qu’il a mélangé les rôles ». Le spectateur, pour sa part, réalise que le soldat égyptien, qui se trouve dans une très délicate situation comprend soudainement son ennemi juif a qui il demande la même compréhension et humanité en retour. Par le détournement du célèbre monologue de Shylock, le film est un vibrant appel à la compréhension mutuelle.
Toutefois, les situations traitées par le cinéma ne sont pas toujours aussi naïves ou pathétiques. Un film comme Night Movie (Gur Heller, 1985) met en scène un adolescent arabe, simple et confiant, arrêté à Tel-Aviv où il se trouvait sans autorisation. Menotté au soldat qui l’a arrêté, ils errent la nuit dans Tel-Aviv. Au lever du jour la patrouille militaire passe relever le soldat, et le lien de confiance qui s’est construit entre le soldat et son prisonnier est tragiquement rompu.
Mais il n’est pas sans intérêt de voir quel regard le cinéma palestinien porte sur la société juive israélienne. « Noces en Galilée (Michel Khleifi, 1987) raconte l’histoire d’un mariage qui se déroule dans un village arabe de Galilée soumis à la loi militaire et au couvre-feu (supprimé en 1966). Comme la fête du mariage va se terminer la nuit, une autorisation doit être délivrée par le gouverneur militaire qui se permet par ailleurs de s’inviter. La force et la beauté de ce film, tourné en Israël, premier à être réalisé par un arabe israélien (mais produit à l’étranger, M. Khleifi vit en Belgique depuis 1970), provient du fait qu’il traite, d’une part, des contradictions de la société israélo-palestinienne, comme la conscience politique, les conflits de génération, les tensions familiales ou l’évolution des comportements sexuels, et d’autre part des contradictions entre Juifs et Arabes d’Israël, en montrant le gouverneur militaire comme étranger à la culture palestinienne.
Alors que Michel Khleifi est né et a grandi à Nazareth, ville israélienne à population essentiellement arabe, un réalisateur palestinien comme Rashid Mashrawi a grandi dans un camp de réfugiés de Gaza, région qui connu depuis 1948 une double domination : d’abord égyptienne jusqu’en 1967, puis israélienne. Rashid Mashrawi est un des seuls réalisateurs palestiniens qui travaille dans l’industrie du film israélien. Ses réalisations, à partir de figures individuelles, mettent en avant le thème du piège dans lequel vit le Palestinien: piégé entre deux pays, piégé car toujours considéré comme un intrus, piégé car la société israélienne l’a rendu invisible (Across the border, 1987 ; Shelter, 1989 ; The Magician, 1993).
Quand un certain cinéma israélien a compris, avec plus ou moins de bonheur, que la destinée des juifs et des arabes était commune, il a cessé d’ignorer, de mépriser ou de caricaturer l’Arabe, pour l’intégrer comme une figure à part entière, c'est à dire complexe et multiforme, de la société israélienne. Cet entendement a non seulement permis l’éclosion d’un cinéma réalisé par des palestiniens, fait marquant s’il en est, mais a aussi permis le traitement par le cinéma israélien d’un thème tabou pour les deux communautés : l’amour entre Juifs et Arabes. Longtemps considéré comme intolérable sinon ignoré, l’amour ‘inter-ethnique’ est traité dans les années 1980 notamment dans « A Narrow Bridge » (Nissim Dayan, 1985), dans « Torn Apart » (Jack Fisher ,1989), ou dans « Crossfire » (Gideon Ganani, 1989). Quant à Michel Khleifi, il a réalisé en 1998 un documentaire sur ce sujet au titre sans équivoque "Mariages mixtes en terre sainte".
Depuis le début de la même décennie, le cinéma israélien interroge les conséquences de l’occupation israélienne des « territoires » en termes d’effets sur les relations entre Juifs et Arabes, soit dans un contexte politique et émotionnel (The Smile of the Lamb, Shimon Dotan, 1986), soit à travers des relations d’amitié et de traîtrise, ou soit encore à travers les sentiments ambivalents des Israéliens qui soutiennent les organisations palestiniennes clandestines (Fellow Travellers, 1983, Streets of Yesterday, 1989). La question brûlante de la difficulté des relations entre Juifs et Arabes a aussi été traitée assez crûment par Amos Gitai dans trois documentaires : « House » (1980), « Wadi » (1981) et « Field Diary » (1982).
Nul doute que depuis les années 1980, à travers des films parfois pessimistes, violents ou tragiques, d’autres visions de la coexistence entre Juifs et Arabes ont éclos comme une demande pour une
meilleure compréhension entre adversaires, ce qui reflète une conscience croissante de la nécessaire reconnaissance et compréhension de l’Autre - basée sur le simple fait que l’un et l’autre sont sur la même
terre et vont y rester - pour parfois déjà prendre la figure du partenaire.
Sponsors cinéma israélien: ParisAviv Ltd.