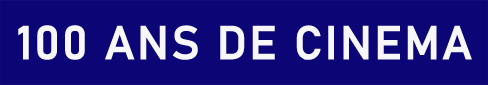
Cinéma bourékas
Depuis 1948 le cinéma israélien a produit de nombreux films évoquant de près ou de loin l’antagonisme ethnique entre les communautés ashkenaze et sépharade. L’image de celle-ci a été longtemps controversée. Une controverse qui subsiste jusqu’à ce jour, même si d’autres communautés d’immigration plus récente (les Ethiopiens, les Russes…) ont pris place dans le paysage cinématographique israélien.
Focus sur un réel « phénomène de société ».
Précisons d’entrée de jeu que la majorité des films qui traitent du problème sépharade ont été souvent médiocres, ou très moyens : ce qui leur a valu la qualification péjorative de films « bourékas » (du nom d’une pâtisserie à base de pâte feuilletée, que l’on remplit selon les goûts, d’où l’idée d’un cinéma alimentaire). En raison de leur impact sur le public ils ont ici toute leur place.
Deux cas à part : Moshe Mizrahi et Nissim Dayan
Très différentes sont les œuvres de deux jeunes cinéastes comme Moshe Mizrahi (Rosa, je t’aime, La Maison de la rue Chelouch, La vie devant soi, Filles, filles …) et Nissim Dayan (La lumière du néant), qui se caractérisent par un souci d’authenticité et de sincérité. Les autres réalisateurs de talent n’ont pas pris au sérieux ni la question sépharade, ni les problèmes sociaux ; l’avant garde israélienne a tout bonnement mésestimé ces aspects de la société, se contentant de décrier le genre.
Si Moshe Mizrahi a formidablement reconstitué l’univers dans lequel évolue ses personnages, dans une tradition juive sépharade authentique, ce n’est cependant pour lui, pas la dimension orientale qui est au cœur de la fiction. Quant à Nissim Dayan, son originalité, dans « Lumière du néant » (1974) et « La fin de Milton Lévy » (1980), réside dans son analyse minutieuse de la société israélienne et de ses faiblesses. Ses objectifs sont politiques : dans le premier film, il développe une analyse des rapports au sein d’une famille de Tel Aviv qui habite un quartier populaire moralement dangereux pour la jeunesse ; le second traite des périls et des effets néfastes de l’indigence économique et culturelle que connaît la population sépharade d’Israël.. Tous les personnages de Nissim Dayan sont des marginaux qui tentent de s’intégrer à la petite bourgeoisie. Il montre que les dorures de ce milieu ont vie fait de craquer et dévoilent alors dépravation et forfaiture. Quant aux relations entre ces marginaux sépharades et l’establishment ashkénaze, l’amertume, les rancoeurs et la méfiance les rendent tout simplement impossibles.
Il est intéressant de comparer l’image du sépharade chez Mizrahi et chez Dayan. L’origine et les traditions, pour le premier, font sa force, même si elles sont parfois lourdes à porter, tandis que chez le second, elles constituent une faiblesse. Ou en tout cas paraissent telles dans le contexte socioéconomique d’Israël.
La campagne de dénigrement contre les films bourekas qualifiés de « levantins » constitue un épisode tragi-comique du cinéma israélien. L’un des représentants les plus en vue de cette tendance, se nomme G. Ovadia : ses mélodrames sirupeux et ses comédies galvaudées ont soulevé autant de protestations qu’elles ont fait entrer d’argent dans ses caisses ! D’origine iranienne, il est né à Bagdad. Après avoir été tour à tour acteur, metteur en scène de théâtre et réalisateur, il a eu l’occasion de se rôder au mécanisme du spectacle tant en Irak qu’en Iran, et pour lui, un film est un conte de fée qui doit déboucher sur une moralité. Il a remis au goût du jour l’antique magie des Mille et une nuits, adaptée par sa propre naïveté et son sentimentalisme sincère. On lui doit notamment « Arianna » (1971), « Fiské s’en va –t-en guerre (1971), « Nurith » (1972) », et le plus célèbre de la série « Sarith » (1974). Il en a tourné beaucoup d’autres. Il n’a jamais eu le désir de se comparer aux grands du cinéma mondial, mais l’ensemble de ses films a totalisé trois millions de spectateurs. Préoccupés, sincèrement ou non, de l’avenir du cinéma israélien, intellectuels et critiques s’inquiétèrent du fait que le Centre Israélien du Film, par le jeu des ristournes, finançait des films bâclés avec des budgets infimes et ils s’ingénièrent à ce qu’on coupe les fonds à Ovadia. Pour ces intellectuels et ces critiques, la référence devait être le cinéma occidental et ses grands noms. Mais on peut penser que c’est aussi pour sauvegarder l’occidentalité du cinéma israélien et le préserver d’une intrusion orientale qu’ils condamnèrent les films d’Ovadia, en particulier sa façon de transposer des situations et des personnages empruntés à des films turcs et iraniens dans un décor israélien. C‘était sans doute une grande partie du public israélien que l’on contestait dans ses goûts ainsi que les spécificités culturelles et linguistiques de l’Orient.
Le phénomène « Salah Shabati »
Bien avant les films d’Ovadia, Mizrahi et Dayan, le cinéma israélien avait connu le phénomène « Salah Shabati », réalisé en 1964 par Ephraïm Kishon. C’est probablement le film qui, par son impact commercial a le plus mis en évidence l’antagonisme ashkenaze/sépharade. L’on pourrait cependant citer les films « Terre » (1947) et « Jérusalem cité fidèle » (1955), qui avaient déjà mis l’accent sur les conflits provoqués par la mise en présence de cultures différentes importées par les nouveaux immigrants dans le jeune Etat.
« Salah Shabati » a fait 1.200.000 entrées : ce fut une véritable bombe dans le ciel du cinéma israélien. Ce fut aussi la première fois que l’on prenait au sérieux un film israélien à l’étranger puisqu’il reçut le premier prix au festival international de San Francisco et qu’il fut nominé à l’oscar. L’acteur principal, Haïm Topol, devint du coup une vedette internationale. Le succès de « Salah Shabati » éclipsa littéralement la douzaine de films produits cette année – là.
Cce film est constitué d’épisodes cocasses qui mettent en scène une famille de nouveaux immigrants, fraîchement débarqués du Maroc. Ils sont acheminés vers un camp de transit, en attendant d’obtenir un logement décent et durable. Salah Shabati, le père de famille, met à contribution tout son bon sens populaire pour résoudre au plus vite et au mieux les problèmes de son intégration sociale. Au-delà de l’image du nouvel immigrant jeté au beau milieu d’un pays dont il ignore tout, Ephraïm Kishon a fait de son héros le symbole satirique du conflit issu de l’antagonisme entre deux cultures différentes.
Salah représente la mentalité orientale, l’hospitalité, la franchise, le bon cœur, mais aussi tout ce que les Ashkenazes en Israël reprochent aux Orientaux. Il est paresseux, passe ses journées à jouer aux dominos, détourne de l’argent gagné par ses enfants pour payer son eau de vie. La brute au grand cœur ! Mais il est encore sympathique et intelligent et ses défauts vont permettre de mettre à nu l’hypocrisie des Ashkenazes cultivés, entre autres, celles des fonctionnaires gouvernementaux à qui il a affaire et qu’il montre gonflés par une idéologie creuse.
Curieusement, Salah n’a pas été considéré par le public sépharade comme un personnage négatif, au contraire. Bien que Topol, l’acteur, et Kishon, le réalisateur fussent ashkenazes, on a trouvé que leur héros rendait justice à la communauté orientale. Et pourtant, si on pousse un peu l’analyse, on s’aperçoit que le degré de subversion de « Salah Shabati » est pratiquement nul. Le film n’aborde pas les problèmes réels, culturels et économiques des Sépharades, que le héros gomme au contraire complètement. S’il a cependant cristallisé leurs préoccupations, c’est en raison d’un ensemble de circonstances conjoncturelles. : en particulier les problèmes liés aux grandes vagues d’immigrations des années 50 et 60.
Salah Shabati » a été le premier produit d’un genre qui a connu par la suite on l’a dit, une grande prolifération. Al’étranger, l’image de marque du cinéma isarélien a alors glissé du « film sur les pionniers » à celle du « film sur les antagonismes ethniques ».
Les films de Menahem Golan
Dans les années 70, trois films sur le même thème ont encore touché à un point névralgique la sensibilité du public. Tous trois signés par Menahem Golan : « Lupo » (1970), qui attira 900.000 spectateurs, « Katz et Carasso » (1971), autant et « Kazablan » (1973) qui dépassa à nouveau le million de billets vendus. On peut leur ajouter « Salomonico » (1972) d’Alfred Steinhardt qui attira 700.000 spectateurs.
Lupo, c’est en quelque sorte l’équivalent ashkenaze du Salah Shabati sépharade. Comme lui, il est doté d’une forte dose de bon sens, en même temps qu’il fait preuve d’une grande naïveté et devient le porte – parole de ce quartier populaire. Toutefois, contrairement à Salah et sa famille nombreuse, Lupo n’a qu’une fille. En plus, il est honnête, il ne boit pas et travaille pour gagner son pain. Le film est composé aussi d’une cascade de sketches amusants, au fil d’une trame dramatique plutôt mince. Jusqu’au happy end : la fille parvient à épouser un prince charmant, le héros est indemnisé par la municipalité pour la destruction de sa bicoque, tandis qu’il finit par être reconnupar des gens bien. Tout est bien qui finit bien quand on a de l’argent et qu’on est Ashkenaze !
Selon Golan, l’argent et les mariages sont la solution aux conflits ethniques. Ce qu’il montre encore dans son second film « Katz et Carasso ». dans son troisième film du genre, Golan s’est surpassé dans l’utilisation des poncifs et des stéréotypes. Il a agrémenté le tout de refrains populaires pour offrir au public le film le plus coûteux jamais réalisé alors en Israël.
.Et « Kazablan » a été un énorme succès commercial.
Le scénario, inspiré de la pièce de théâtre de Y. Mossizon écrite dans les années 50 pour susciter une prise de conscience à l’égard d’une réalité sociale injuste, fait certes allusion, ici ou là, aux Panthères noires (à l’époque porte – parole des quartiers pauvres) mais il n’a pas su mettre en relief leur situation réelle et actuelle. Golan n’a fait qu’utiliser le prétexte de cet antagonisme ashkenaze – sépharade pour produire un film à gros budget qui joue sur la sensibilité des gens à l’égard de ces problèmes.
« Salomonico » et les stéréotypes
Avec « Salomonico » d’Alfred Steinhardt, les Marocains abandonnent l’avant – scène au profit des Saloniciens. Mais le schéma reste le même. A la fin de l’histoire qui se termine comme il se doit par un mariage entre la fille du héros et un jeune Ashkenaze, tout le monde chante et danse de bon cœur et les antagonismes – qui du reste n’atteignent jamais un point crucial – sont oubliés. L’épilogue pourtant vient contredire l’image d’Epinal : l’individu ne peut rien changer à da propre nature. Salomonico est né avec la « tare » d’être sépharade et il ne pourra jamais ressembler à un Ashkenaze. Il a pourtant essayé de se rapprocher de ces intellectuels, d’habiter leur quartier, ils lui ont signifié leur refus ; En définitive, il se retrouve dans sa vieille maison de Jaffa où il conservera le même mode de vie.
Coiffeuse et prostituée
D’autres films font encore référence aux conflits ethniques, ainsi « Margo » (« Mon amour à Jerusalem ») (1969, où l’auteur raconte l’histoire d’amour entre deux personnes que tout sépare ; Lui, l’intellectuel ashkenaze et elle, coiffeuse, d’origine marocaine, tous deux en butte avec leur milieu parviennent tant bien que mal à vivre leur passion. Il n’en est pas de même pour une autre Margo, de Dimona (ville du sud du désert du Néguev) dans le film « La reine de la rue » (1971). On la voit d’abord échapper à son destin – la pauvreté et la prostitution, puis en être irrémédiablement à nouveau victime. Margo se fera violer par des ex-clients, perdra son enfant et retournera au trottoir.
L’origine ethnique dans de nombreux films israéliens est clairement désignée par la référence à l’environnement, le mode de vie et le langage qi constituent tour à tour des éléments positifs et bénéfiques, et négatifs et destructeurs. L’existence même et le succès commercial de cette production n’ont pas manqué de soulever de sérieuses questions. Malgré leurs défauts et souvent leurs graves lacunes, ces films nt empli une fonction qui, sans eux, serait demeurée inoccupée ; Ils ont, même maladroitement, agi comme un signal d’alarme pour les dirigeants les amenant à considérer la question sépharade et les persistantes injustices sociales de la société israélienne.
Les conflits ethniques à l’écran aujourd’hui
Les films « ethniques » s’ils se font plus rares qu’à cette époque, n’ont pas pour autant déserté les écrans israéliens. Ils ont suivis (ou précédé ?) de manière intéressante l’évolution de cette société si mouvante .
(Lehem, Shur, Tipat Mazal, Ha hole haava mi shiquoun gimel)
Attention! Publicité (18+).